VIENT DE PARAITRE :
Retraitement. Six mois pour que la vie change… ou pas (2025)
DERNIERS PARUS :
Rêveries sur les coteaux. Carnets du compagnon du promeneur solitaire (2024)
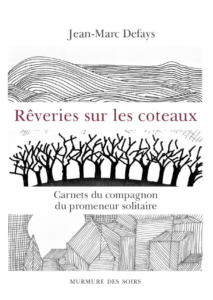 – Professeur de A à Z. Libres propos sur l’enseignement et l’Université (2024)
– Professeur de A à Z. Libres propos sur l’enseignement et l’Université (2024)

